"Cette ville pue la mort, marmonne l’inspecteur Éric Darrieux, adossé à la portière de sa vieille Peugeot. Tu m’entends, Grenoble ? La mort par tous tes trous ! Plus de quarante ans que je roule pour toi. Quarante ans que j’use mes semelles dans tes rues et tes escaliers en or gris. Et que m’as-tu donné en échange ?" M. L.
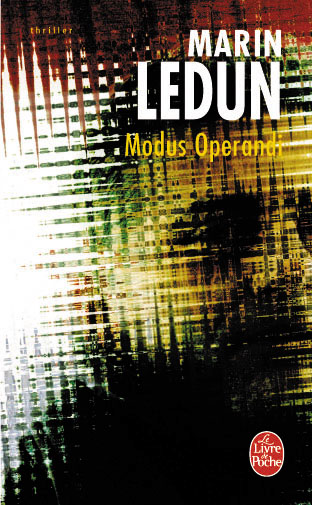 |
| Page de couverture de "Modus Operandi". |
Marginal opiniâtre et alcoolique invétéré, Éric Darrieux enquête sur des disparitions d’enfants à Grenoble. Témoins fuyants, preuves confuses... À travers les brouillards de l’alcool, il poursuit un passé tourmenté dans les méandres de la mémoire urbaine. Ce livre a été élu Plume 2007 du Premier Roman.
J’ai croisé Marin la première fois en 2010, lors d’un salon en l’honneur de Frédéric Dard à Saint-Chef. Marin venait de sortir "Un singe en Isère", une aventure de Gabriel Lecouvreur, plus connu sous le nom "Le Poulpe". Nous nous sommes recroisés au fil des salons littéraires, avons sympathisé. C’est un garçon très calme, très gentil, avec un visage "doux", comme l’on dit. Mais il ne faut jamais se fier aux apparences. Il suffit de lire l’œuvre de Marin pour se rendre compte comment il est torturé et imaginatif.
Dans "Modus Operandi", Ledun nous conte la vie d’Éric Darrieux, un homme marginal, légèrement (sic) asocial, et surtout profondément alcoolique. Darrieux enquête sur d’étranges disparitions d’enfants dans la ville de Grenoble. Ville qu’il exècre au plus haut point. Il n’accumule aucune preuve, rame, s’enlise, se perd dans les brouillards de l’alcool qu’il ingurgite au fil des pages. Il est "LE" personnage type du roman noir, paumé, rejetant la société, rejeté par cette même société. Le genre de gars que l’on déteste, tout en ayant une certaine pitié, empathie pour lui. D’ailleurs, si l’on a une certaine sympathie pour lui, c’est plus grâce à Catherine, l’opposée de Darrieux, sociable, douce, elle n’a pas cette haine viscérale de l’autre, ne le rejette pas, elle ne se noie pas dans l’alcool.
Catherine est belle, jeune, et médecin légiste, elle soigne Darrieux de ses douleurs en lui injectant de la morphine. Catherine est une des seules personnes que Darrieux aime. S’il avait été plus jeune, il aurait tenté sa chance, il aurait essayé de la séduire. Mais un alcoolique, un homme qui se laisse aller, un homme blessé, un homme perpétuellement en colère, peut-il charmer une femme ?
Puis il y a cette enquête sur ces gosses disparus qui lui pourrit encore plus la vie, qui le fait sombrer de plus en plus dans les abysses de l’alcool. Mais Darrieux veut se battre, il veut trouver les coupables, il est sûr et certain de les tenir, il lui manque si peu pour les faire tomber. Seulement Rosa, son supérieur, ne veut pas vraiment l’aider, c’est tout juste si au contraire il ne lui met pas des bâtons dans les roues. Encore un qui l’entraîne vers ce rejet de la société, ce rejet de l’autre, qui lui fait encore plus détester cette ville, le boulot de flic, sa vie…
Voilà ce que narre Marin dans ce livre, le rejet d’un homme, sa colère, colère contre la société, colère contre les autres, mais surtout colère contre lui-même. Celui que Darrieux déteste le plus, c’est certainement lui-même. Et s’il était son pire ennemi ?
"Modus Operandi" est un roman noir, très noir, l’histoire d’un homme à bout. Mais derrière cette écriture sombre, Marin réserve une belle surprise à ses lecteurs : au fil du livre, il nous mène dans Grenoble, mais aussi dans les tréfonds de l’esprit torturé d’Éric Darrieux. Un livre à découvrir.
Rencontre avec Marin Ledun
 |
| Marin Ledun Photo © José-Luis Roca / Flammarion. |
Sébastien Mousse : Bonjour Marin, tout d’abord merci de m’accorder un peu de temps pour les lecteurs de Résonance. "Modus Operandi" est un roman noir pur jus, c’est un genre dans lequel tu te plais à écrire ?
Marin Ledun : Bonjour Sébastien. Merci à toi pour ta lecture de "Modus Operandi", mon premier roman publié. Comme le dit Robin Cook dans "Mémoire vive", le but du roman noir, dans ce qu’il a de mieux, a toujours été de détruire le mal en le décrivant ; c’est une littérature positive et non pas négative, ne serait-ce que parce qu’elle montre tout ce qui dans notre société est négatif. Je crois que cela résume assez bien ma philosophie de vie et mon approche de l’écriture. C’est un genre dans lequel je me sens bien. Que la littérature noire perdure, depuis des décennies, en dépit de ventes modestes – et ce, avec une constance qui devrait faire d’elle, avec les littératures romantique et érotique, le bonheur des esprits comptables – et de son caractère subversif, me ravit au plus haut point.
La faiblesse croissante des dotations publiques pour la culture, la paupérisation des auteurs, l’explosion du phénomène de "best-sellerisation" engendrant des écarts sans cesse croissants entre les meilleures ventes de romans et le commun des écrivains, la marketisation de l’édition, la prolifération des publications, les fâcheux de l’autofiction, célébrés en héros des temps modernes, la censure, la morosité ambiante, rien n’y fait : le "noir" continue, du fond de sa cave, de produire avec pugnacité des histoires qui surprennent, réinventent les codes littéraires et parlent du monde dans lequel nous vivons.
Des festivals se créent chaque année aux quatre coins de l’Hexagone pour le célébrer, des journalistes littéraires lui consacrent des pages entières de chroniques dithyrambiques inversement proportionnelles à la réalité des chiffres de ventes, des lectrices et lecteurs enthousiastes se précipitent dans les librairies ou médiathèques qui ont le bon goût de le mettre en avant, d’autres créent des sites, des groupes Facebook, des blogs, parfois – souvent ! – d’excellente facture, pour le décortiquer et le mettre à l’honneur, des éditeurs de noir courageux se lancent dans la jungle du "marché littéraire", souvent avec succès, des concours de nouvelles noires fleurissent, rejoignant les rangs de ceux qui existent depuis des années, envers et contre tous les pronostics qui font de la nouvelle, en France, un genre désuet, peu commercial et voué à l’échec, et j’en passe.
Mille fois, on nous a vendu la mort du genre, mille fois la littérature noire a resurgi, longue ou courte, là où on ne l’attendait pas. Il n’y a qu’à lire aujourd’hui "Les derniers jours d’un homme" de Pascal Dessaint, "Le mur, le kabyle et le marin" d’Antonin Varenne, "Versus" d’Antoine Chainas, "Aux animaux, la guerre" de Nicolas Mathieu ou encore des "Pukhtu" de DOA, pour ne citer que ces romans-là, pour s’en persuader. Voilà qui est proprement stupéfiant, vous ne trouvez pas ?
SM : Dans "Modus operandi", le personnage de Catherine, la médecin légiste, est très important. La médecine légale est une science qui fascine l’auteur de polar, de roman noir que tu es ?
ML : Au risque de décevoir, j’avoue : ce n’est absolument pas le cas. En tout cas, ça ne l’était pas au moment de l’écriture de M.O., il y a maintenant neuf ans, presque jour pour jour. Une autre vie, d’autres temps, loin, très loin de l’univers du roman noir, dont j’ignorais à peu près tout, des codes du polar. Je travaillais à France Télécom, en région grenobloise, comme ingénieur de recherche. Aujourd’hui, c’est moins la médecine légale qui m’intéresse (cet aspect est très peu présent dans mon travail) que son aspect clinique, basé sur l’exposition des faits, que j’essaie d’appliquer, par extension, à mes romans. Quand j’élabore mes personnages. Leurs relations. Les mécaniques sociales dans lesquelles ils évoluent. Raconter l’histoire des hommes après l’analyse de leurs actions ou d’après l’analyse de leur corps post-mortem relève sans doute d’une démarche similaire, après tout. Il paraît que les spécialistes du noir appellent cela "l’approche behavioriste". Moi, je préfère parler de "sociologie critique romancée". Ça fait moins scientifique, mais souvent, ça tape juste, non ?
SM : Tu es un auteur extrêmement prolixe, en quelques années, une huitaine, tu as écrit 14 romans, 3 essais, 3 livres jeunesse, je ne parlerai pas des nouvelles, pièces radiophoniques. Tu vas rentrer dans la légende des forçat de l’Underwood… tu écris combien d’heures par jour ?
ML : Je ralentis, je ralentis… La cadence était trop élevée. Je vieillis aussi. Mais surtout, je passe de plus en plus de temps sur chacun de mes romans, sur la structure, sur les personnages, sur la petite musique des phrases, sur le style. Tout cela, d’une façon qui est la même que celle où j’étais étudiant, puis salarié : du lundi au vendredi, toute la journée. Sauf quand je déborde. La cadence naît aussi de l’urgence. Celle de l’écriture, bien sûr, mais aussi celle des nécessités matérielles. L’écriture est ma seule source de revenus. Les premières années ont été difficiles. Seule une poignée d’élu(e)s ont la chance d’un large public. Or, j’écris du roman noir… J’ai accepté ou provoqué des sollicitations diverses et variées. Et vous savez quoi ? Je ne regrette rien.
SM : Ton roman "Les Visages écrasés" va être adapté au cinéma par Louis-Julien Petit, avec Isabelle Adjani dans le rôle principal. On ressent quoi lorsque l’on apprend ce genre de nouvelle ? C’est une consécration ?
ML : La nouvelle, je l’ai apprise directement d’Isabelle Adjani. Elle a été touchée par le roman. Par sa critique du monde du travail – dont je ne suis pas un spécialiste, mais un témoin, du fait de mon passé de salarié à FT. Et par le rôle principal de médecin du travail, Carole Mathieu. Elle a transmis son envie au réalisateur Louis-Julien Petit, auteur d’un magnifique "Discount", sorti début 2015, qui y apporte sa vision du monde et du cinéma, les acteurs avec qui il a déjà travaillé, notamment la géniale Corinne Masiero. J’y collabore. Le tournage débute mi-novembre, le film sortira en 2016, dans la foulée.
Pour moi, c’est une forme de reconnaissance. De la critique sociale portée par le roman, d’abord. De mon travail, ensuite. De l’enthousiasme de mes lecteurs, enfin. Ça peut paraître étrange, mais ce roman et son succès sont le fruit d’un travail collectif. Des amis éditeurs qui y ont cru, à l’éditeur, Jean-Christophe Brochier, qui l’a publié, en 2011, aux soutiens indéfectibles dont j’ai bénéficié après sa publication, des lecteurs, des chroniqueurs, des bibliothécaires et des libraires qui l’ont défendu, des responsables syndicaux qui m’ont invité à venir en parler dans leur entreprise, des amis, enfin, et maintenant, de personnalités talentueuses du cinéma. Ce roman, c’est le monde du travail aujourd’hui. Il appartient à tout le monde.
SM : Tu es dans une revue réservée principalement aux professionnels du funéraire, tous ces métiers inspirent l’auteur de roman noir que tu es ?
ML : Oui ! Vous ne me croirez peut-être pas, mais depuis un épisode de "La Quatrième Dimension", dont je ne garde qu’un vague souvenir d’enfant, c’est une profession qui me fascine, parce qu’elle est universelle. Nous naissons. Nous vivons. Nous mangeons. Nous souffrons. Nous aimons. Nous mourrons. Toutes et tous. Et dans le monde que nous traversons, tout à un prix. Même la mort.
SM : Quelle est ton actualité littéraire du moment, Marin ?
ML : Mon dernier roman, "Au fer rouge", est paru en janvier. Il vient clore le diptyque basque entamé l’année passée avec "L’Homme qui a vu l’homme", qui rencontre un grand succès. Je publie en novembre une nouvelle intitulée "Quelques pas de danse", dans un recueil concocté par la fureur du noir, à l’occasion du festival noir sur la ville de Lamballe. Il s’agit de l’histoire d’une jeune femme amputée d’une jambe dont le rêve est de devenir danseuse. Et je travaille actuellement sur mon prochain roman – chuuut ! – qui devrait paraître à l’automne 2016 chez Ombres Noires.
SM : Marin, je te remercie d’avoir répondu à mes questions.
ML : Merci à toi.
Sébastien Mousse
Thanatopracteur
Éditeur l’Atelier Mosésu










Suivez-nous sur les réseaux sociaux :